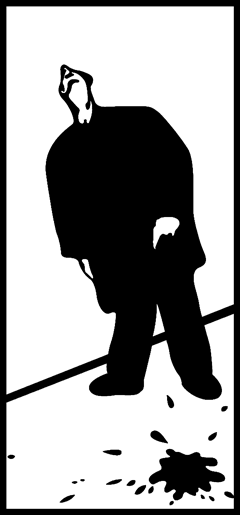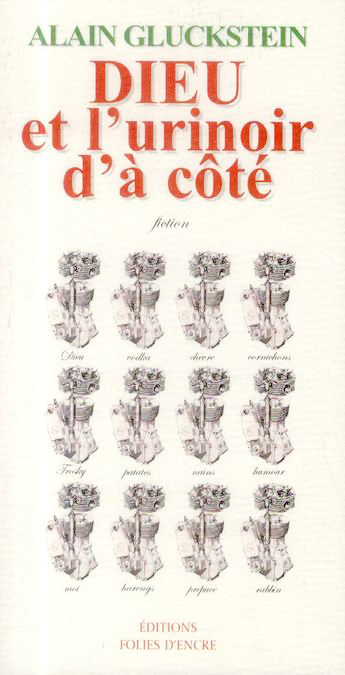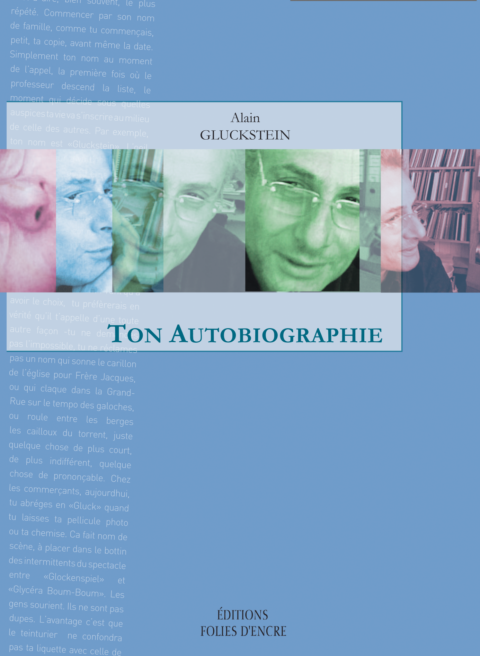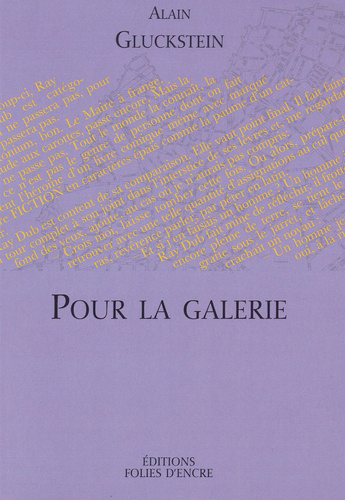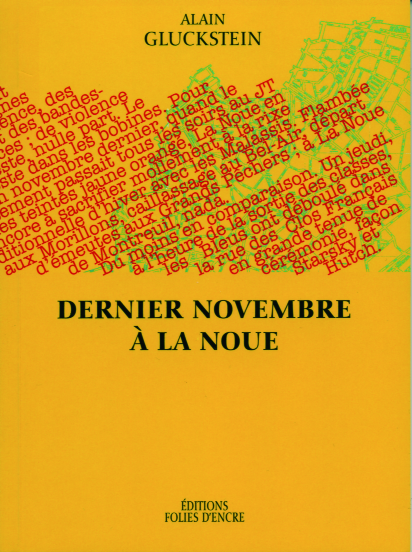La Muette après le passage de l’oublieur
Gare à ton épiderme, lecteur qu’on pince sans rire, tu risques l’hématome sévère ! Sur le thème archi rebattu de la mémoire, Alain Gluckstein, l’auteur de la trilogie de La Noue et de Nos grands hommes propose la conférence-fiction la plus hilarante qu’on n’ait jamais imaginée : Jeanne d’Arc y fait du dromadaire en doudoune en compagnie d’Hamlet ; sous le regard d’Ardois le-Lacanien et de Wu l’hypermnésique, Rousseau joue à la tombola avec une bonne sœur, tandis que l’oublieur passe et repasse à la Muette ! Tout cela suit une logique imperturbable et délirante. Une fois le livre fermé, on se pose la question : et si on tenait là, au fond, le livre le plus sérieux, et le plus grave de la décennie, le seul possible, peut-être, sur un tel sujet ?
À propos
Peut-on parler de la mémoire en évitant à la fois la leçon trop bien apprise du souvenir obligé et une forme béate d’épicurisme qui nous inviterait à nous délester non seulement de la mémoire mais du savoir ? Qu’on ne s’attende pas, en lisant La muette après le passage de l’oublieur, à une plaidoirie en faveur de l’un ou l’autre terme de l’alternative. Les conférences sur le devoir de mémoire ne manquent pas, mais, moqueur, l’ouvrage est la transcription d’une conférence d’un genre un peu énigmatique — une « conférence-fiction »— censée avoir été prononcée, sur commande, au centre Medem, qui tire son nom d’un des théoriciens du Bund, le parti ouvrier juif fondé à Vilna en 1897, et perpétue de nos jours l’héritage socialiste et laïque de l’« Arbeter Ring ». Une des définitions possibles de la conférence-fiction pourrait être « conférence pour rire » — et de fait, on rit. Comme les autres livres d’Alain Gluckstein, les récits qui s’entrecroisent ici cultivent le style de l’épopée. Loin de l’économie littéraire minimale, le texte, dans sa faconde, mime la narration orale avec ses parenthèses, ses détails, et ses listes poétiques ou comiques, sérieuses et fantaisistes. Des personnages hauts en couleurs, comme Wu l’hypermnésique ou Ardois-le-Lacanien, se mêlent à Jean-Jacques Rousseau, à Jeanne d’Arc chez les Hutus et les Tutsis, et à un professeur très ordinaire, Ox, qui pourrait bien se munir d’une doudoune pour se rendre aux Bahamas ou d’un canot de sauvetage avant la traversée du Sahara.La muette après le passage de l’oublieur nous porte à réfléchir de manière originale à ce que signifie la maxime « ne rien oublier », ou des banalités comme « on ne sait jamais ». Le texte nous entraîne dans une dialectique serrée. La question n’est en effet pas utilitariste. On ne sait certes jamais si, contre toute évidence immédiate, on n’aura pas besoin dans l’avenir de savoir quelque langue oubliée. Mais le vrai problème est celui de la jouissance. Deux grandes scènes se répondent l’une à l’autre dans ce récit : le cauchemar du devoir de mémoire et un épisode relaté par Rousseau dans la neuvième promenade des Rêveries du promeneur solitaire. On se souvient que dans cette rêverie, Rousseau, désespérant du bonheur, cherche dans ses souvenirs des sujets de contentement. Une des meilleures satisfactions qu’il évoque se passe à la Muette — lieu bien étonnant pour celui qui aime parler — et concerne un oublieur. On a oublié ce qu’était cet ancien métier d’oublieur. L’oublieur fabriquait des petits gâteaux nommés « oublies » qu’il faisait jouer aux dés, ou tirer au sort. Il annonçait son arrivée en criant : « oublie, oublie ». Dans la scène racontée par Rousseau, les oublies réussissent à celles qui les dégustent ; c’est toute une classe de jeunes pensionnaires au visage ingrat qui devient aimable ainsi régalée par la générosité de Rousseau qui détourne le jeu d’oublies pour que les filles soient gagnantes à tous les coups. Car au jeu d’oubli, on ne gagne pas toujours ; parfois, c’est l’oublieur qui gagne, et qui repart avec l’oubli(e). Alors, les aïeux morts assassinés par les nazis peuvent crier en rêve : « souviens-toi ». Ardois-le-Lacanien est muet dans le roman, mais l’ardoise est à double sens : on y note ses dettes, mais sur elle, rien ne s’inscrit définitivement. C’est par une référence à Hamlet que s’ouvre l’ouvrage d’Alain Gluckstein qui n’a sans doute pas oublié que Lacan érige Hamlet au rang de mythe dans le séminaire Le désir et son interprétation. Le devoir de mémoire est animé par la passion du père : « Hamlet, le père mort, ne laisse pas tranquille Hamlet, le fils vivant » (p. 18). Hamlet le fils sacrifie son désir pour venger son père assassiné. Mais d’où vient le commandement ? À empêcher les vivants de vivre, on empêche aussi les morts de mourir, rappelle Alain Gluckstein. Et on s’empêche de pleurer les disparus à la mesure de la perte infligée. Le livre est une méditation sur la perte. L’hypermnésique ne perd jamais rien ; il reconnaît et toujours retrouve. Qu’est-ce qu’on rate quand on ne perd rien ? Perdre est cependant abyssal comme le rappelle la description minutieuse des recettes comportementalo-cognivistes proposées à ceux qui tentent de retrouver l’objet perdu, comme les séquences-vidéo qui défilent devant celui qui ne peut remettre la main sur ses clés de voiture. Il arrive qu’on perde ce à quoi on avait précisément conféré la fonction d’aide-mémoire, comme un carnet des bonnes idées. Il arrive enfin que, dans la vieillesse, on perde jusqu’à la mémoire elle-même, c’est-à-dire, comme l’exprime très justement Alain Gluckstein, qu’on ne se souvienne même plus qu’on a oublié.
Peut-on enfin être sûr, dès lors qu’on fait le pari de parler, de ne pas enjoliver ? Après Derrida dans La grammatologie, Alain Gluckstein reprend le terme de l’ornement. Hamlet, au moment où il se met au service du père, cherche à écarter de sa mémoire les frivolités de la jeunesse. Mais Rousseau, au moment où il présente ses Confessions assure le lecteur qu’il n’a jamais employé d’« ornement indifférent » que pour pallier « un défaut de mémoire », aveu vertigineux pour le lecteur qui prend au sérieux le projet rousseauiste de dire « toute la vérité ». Ne pas renoncer aux roses de la vie, c’est entre autres choses se mettre à l’école de Rousseau. La jouissance se travaille, et si elle commence par le désir, c’est aussi dans les mots et dans le « bien-dire » de la littérature que celui-ci fraye son chemin pour accorder à la vie ce que la vie réclame de plaisir immédiat. La lecture des Confessions est ainsi, bien plus qu’aucune émission de télé-réalité, un enseignement sur ce qu’est une vie — ce qu’on en retient et ce qu’on laisse à l’ornement indifférent, ce qui fait trace et ce qui s’efface.
Hélène L’Heuillet, Raison publique