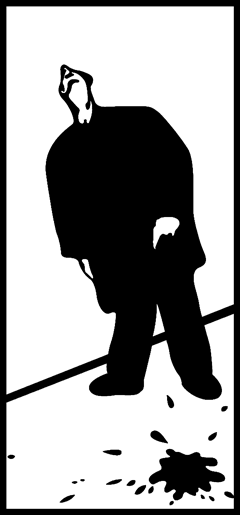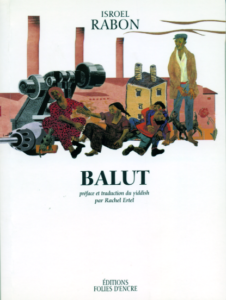
Balut
Récit halluciné de la misère dans les rues, les maisons, les usines où réalisme et grotesque, rêve et quotidien se mêlent. Yossel, un adolescent, déambule parmi les silhouettes de ce cirque, celui du dénuement.
À propos
Par quel miracle la Pologne tout juste indépendante fut-elle entre les deux guerres le lieu d’une formidable éclosion de la littérature yiddish ? La Grande Guerre a pourtant démantelé, sapé les structures traditionnelles de la société juive, le contexte économique et politique est on ne peut plus défavorable, mais, dans une sorte de frénésie, à Varsovie, à Lodz, à Vilna, à Minsk naissent revues d’avant-garde, pièces de théâtre et livres illustrés d’images innovantes, cénacles, mouvements et programmes, comme les derniers tirs de fusée d’un feu d’artifice. Certes, la vie colorée et chaleureuse du shtetl n’est plus à l’ordre du jour. « Notre mesure n’est point la beauté mais l’horreur. Nos nerfs ont été creusés comme des tranchées », « Nous avons perdu le baromètre de la sérénité de l’âme. Frissonnez et apprenez : tout est autre, autre, autre » clame-t-on dans les manifestes1. Isroel Rabon, né avec le siècle, contribue à cette ébullition. Menant une vie de bohême, connu pour sa plume incisive, il crée la revue moderniste Lettre en 1936, traduit Rilke, Baudelaire et Villon, peint, écrit des poèmes, publie des romans et nouvelles en feuilletons, avant d’être arrêté par les nazis à Vilna où il s’était réfugié ; il meurt en 1942 dans le camp de Ponary. S’il portait la cravate, ce ne pouvait être que nouée autour de son cou par une lune d’argent2, car Rabon est un homme du peuple et un autodidacte. Orphelin de père, il voit sa mère mendier, son frère fuir en Allemagne pour échapper à la police et sa sœur « mal finir ». Enrôlé dans l’armée polonaise, il sera envoyé au front contre les Bolcheviks. Pourtant, dès quatorze ans, il publie ses premiers vers. C’est à Balut qu’il passe son enfance, ce faubourg de Lodz dont il choisira le nom comme titre du roman dont nous pouvons lire aujourd’hui les six chapitres parus en1934 (une deuxième partie aurait dû voir le jour). À Lodz, ville-champignon surnommée le « Manchester polonais», se côtoyaient sans se mêler une poignée de financiers et de gros industriels et un immense prolétariat– la masse des ouvriers des nouvelles fabriques textiles –, tandis qu’à Balut continuaient de travailler à domicile, sur leurs métiers, les artisans, juifs pour la grande majorité. C’est donc le roman d’un faubourg (il est ainsi sous-titré) dont on ne peut sortir – on y est pris au piège, exclu à jamais du centre –, et plus encore celui d’une rue, la rue Faïferuvké, faite de « deux rangées de petites maisons bancales en bois s’appuyant les unes contre les autres », d’une chaussée de sable noir tassé, ornée de deux arbres « tels de noirs épouvantails calcinés ».Tout commence dans le caniveau de cette rue, en réalité un fossé « assez large pour qu’on puisse s’y étendre aussi confortablement que sur un canapé ». C’est là que tente de faire la sieste Yossef, un petit garçon de huit ans, parmi les tessons, les journaux déchirés, la paille sèche et le crottin. Son père vient de mourir et, s’il aide habituellement sa mère en enroulant les bobines de fil pour la soulager de ses quatorze heures passées quotidiennement sur le métier, aujourd’hui, il s’est offert une pause parce qu’une fête est prévue et qu’il ne veut la manquer à aucun prix. La suite est à peine imaginable : une clairière grouillant d’hommes et de femmes aux visages rubiconds, une danse sauvage, l’ivresse incontrôlable d’un chef de bande, un étang dans lequel la foule se rue pour se rafraîchir et s’ébattre de telle manière qu’il n’y a plus d’équivoque possible, pour finir un combat entre hommes et chiens d’une violence et d’une cruauté à peine soutenables paroxysme d’un chapitre intitulé simplement : « Le bal ». Le ton est donné, ou plutôt l’éclairage : ce n’est pas une littérature réaliste ou naturaliste, mais expressionniste, qui met en scène le grotesque et le macabre, la démesure. Les humains se transforment en marionnettes agitées, en pantins inertes, les visages grimacent, les ombres s’agrandissent, les architectures se tordent, les couleurs sont celles de la gangrène. On pense aux tableaux d’Otto Dix, de Georg Grosz, de Ludwig Meidner, aux paysages urbains désolés de couleur bistre de Felix Nussbaum. Mais c’est sûrement dans La Rue, terrible chef-d’œuvre daté de 1928,qui relate l’errance hallucinée d’un soldat démobilisé en quête d’un gîte, de façon presque onirique, que la manière expressionniste a été poussée à son comble et, plus d’une fois, le lecteur sent ses cheveux se dresser sur sa tête3.Yossef pose sur tout cela un regard fixe, halluciné, ébloui, pour finir par tourner le dos et courir, mais jusqu’où ? Si Yossef reste le personnage principal, il s’éclipse parfois comme s’il en avait assez vu et se voit relayé par sa petite sœur Mirélé (pour la vision terrifiante du cadavre maternel dont la chevelure est fouillée par deux souris qui s’en vont ensuite laper l’écume restée aux commissures des lèvres), le voyou Yankel ou Reb Elie, le propriétaire avare et néanmoins dévoré de scrupules, ce qui permet à l’auteur de multiplier les points de vue. Le lecteur assiste, subjugué, à un défilé de personnages brossés longuement ou simples apparitions, tous trop étranges pour être qualifiés de pittoresques : Schloïmé, le paralytique aveugle sur sa carriole tirée par un chien famélique, Hané, la liseuse aux yeux rouges, Tzivié la rousse dont le corps gras et lourd oscille entre ses prostituées au visage ravagé, l’athlète Boutchik et ses sept fiancées, le casse-cou Yankel, le roides vendeurs à la sauvette qui se rit des policiers sous leur nez…L’impression est celle que décrit l’écrivain dans un de ses vers : « Où que je me tourne, j’entends des portes s’ouvrir, / Et derrière chaque porte, un visage blême rit. »Quelques moments de répit, ici et là disséminés dans le roman, réussissent à percer les ténèbres comme de fragiles lumignons. Ainsi l’installation d’un réverbère dans la rue est comme une petite fête :tout le monde est dehors pour manifester sa joie, on sort les chaises pour venir s’installer dans sa lumière, pour économiser la lampe à pétrole et repriser les chaussettes. Les commerçantes sourient à Mirélé venue faire son marché comme une grande personne, avec plus de sérieux et d’application encore, et lui donnent de bon cœur une botte d’oignons ou quelques pommes à compote. Ou bien c’est le brave Noté qui accepte de montrer à Yossef, gratuitement, les images de son cinématographe, et que de merveilles apparaissent alors quand il fait tourner la roue : Napoléon, le Sultan turc, des Chinois, des poissons à quatre yeux, des baleines, « tout un nouveau monde inconnu et beau ».Le plus beau passage est peut-être celui de l’errance des deux enfants dans la ville au crépuscule, comme ils ne veulent rentrer chez eux ni l’un ni l’autre après l’enterrement de leur mère, enterrement qui n’est qu’un cortège grotesque avec le hurlement des sirènes d’usines en bruit de fond. Ils se sont perdus mais continuent de marcher au hasard, déambulent, épuisés, alors que le jour est tombé quand apparaît, au tournant d’une rue, une immense fabrique illuminée où s’affaire l’équipe de nuit, avec sa grande cheminée qui lance des panaches de flammèches et qui leur semble être un lieu enchanté, « une ville de feu, de milliers de feux et de flambeaux, une ville de flammes, une ville clarté ». Attirés irrésistiblement, ils se blottissent au pied de son mur de brique rouge, « continuent de fixer les vitres éclairées comme les images d’une lanterne magique, et ainsi, les yeux brouillés de larmes, ils sombrent dans le sommeil, sur la pelouse piétinée »,tandis qu’un vent compatissant caresse doucement leurs haillons avant de s’élancer furieux sur la bâtisse.
Françoise Le Bouar, Critiques BNF
Né en 1900 à Gowarczow, près de Radom, en Pologne, Rabon occupe une place à part dans l’histoire de la littérature yiddish, ne serait-ce que par sa réputation très modeste. Il a été redécouvert très tard, à la fin des années 1980, avec la publication en Israël de son roman La Rue (Julliard, 1992). Grandi dans le quartier prolétaire juif de Baluty – Balut en yiddish, comme le titre de son stupéfiant roman -, la banlieue ouvrière de Lodz, Rabon vient d’un milieu très différent de celui de Singer : orphelin de père, voyou dont le frère a dû fuir en Allemagne pour échapper à la police, il a souffert de la faim alors que sa mère mendiait pour vivre. Ecrivain asocial, Rabon ne cesse pas seulement de croire à une vie possible dans le shtetl. Il renonce aussi à toute possibilité de vivre dans une communauté humaine. C’est ce que montre Balut avec une force hors du commun : un demi-monde composé de putains, d’enfants abandonnés, de policiers imbus de leur violence, de parents absents accablés par leur propre misère. La communauté juive prolétaire devient ici une réalité pathétique. Un monde pourri, sale, abject, à des années-lumière du folklore yiddish et dont la seule échappatoire est l’hallucination. Pour s’arracher à ce monde, Rabon est devenu écrivain, critique littéraire et feuilletoniste. Quand éclate la seconde guerre mondiale, il s’enfuit à Vilno, capitale de la Lituanie. On le décrit prostré chez lui, mélancolique. Il abandonne l’écriture, à l’exception de quelques textes où il décrit, sur un ton apocalyptique, les blessés et les morts aperçus lors de sa fuite de Lodz. Les nazis viennent le chercher chez lui en 1942 pour le mener au camp d’extermination de Ponary.
Samuel Blumenfeld, Le Monde